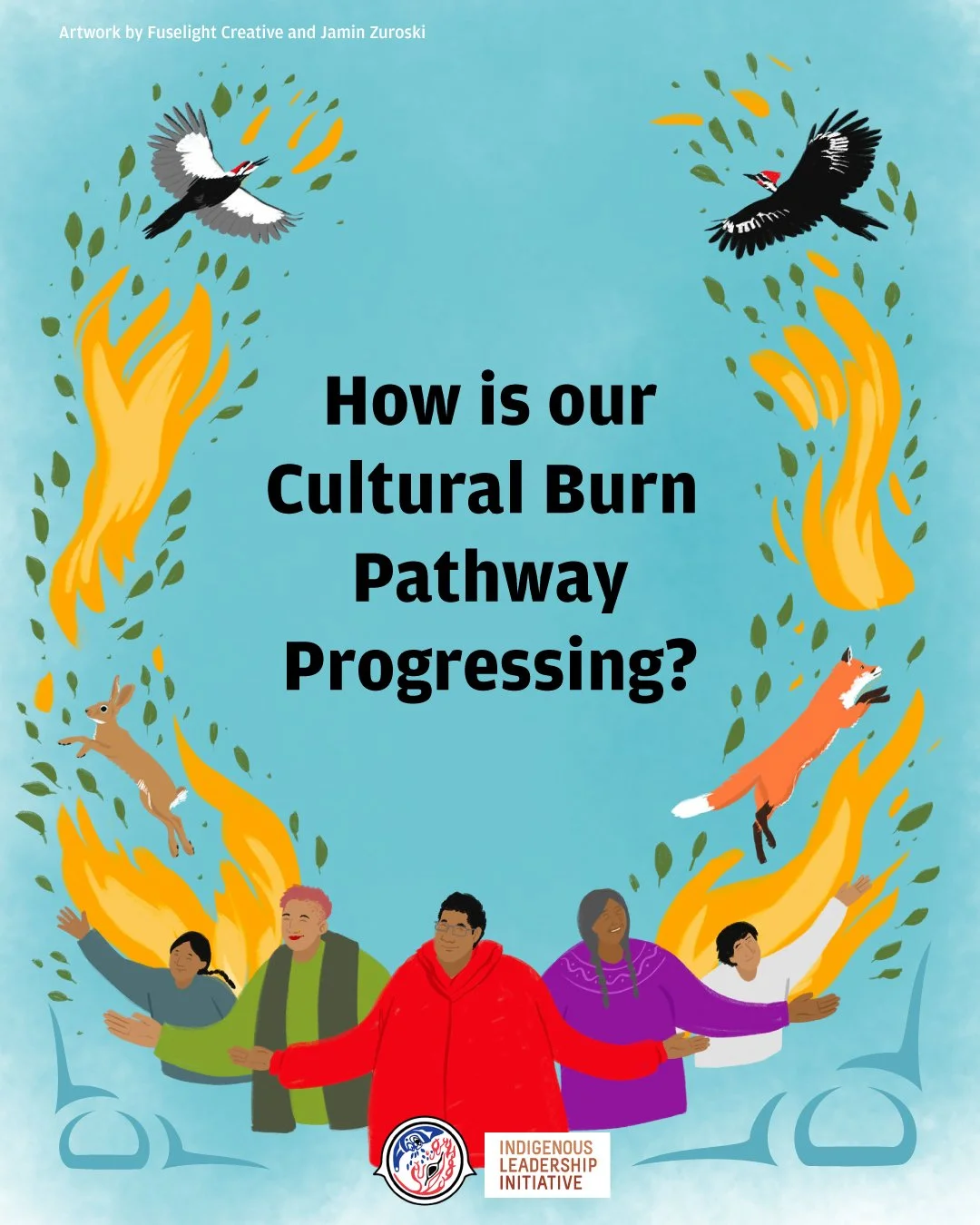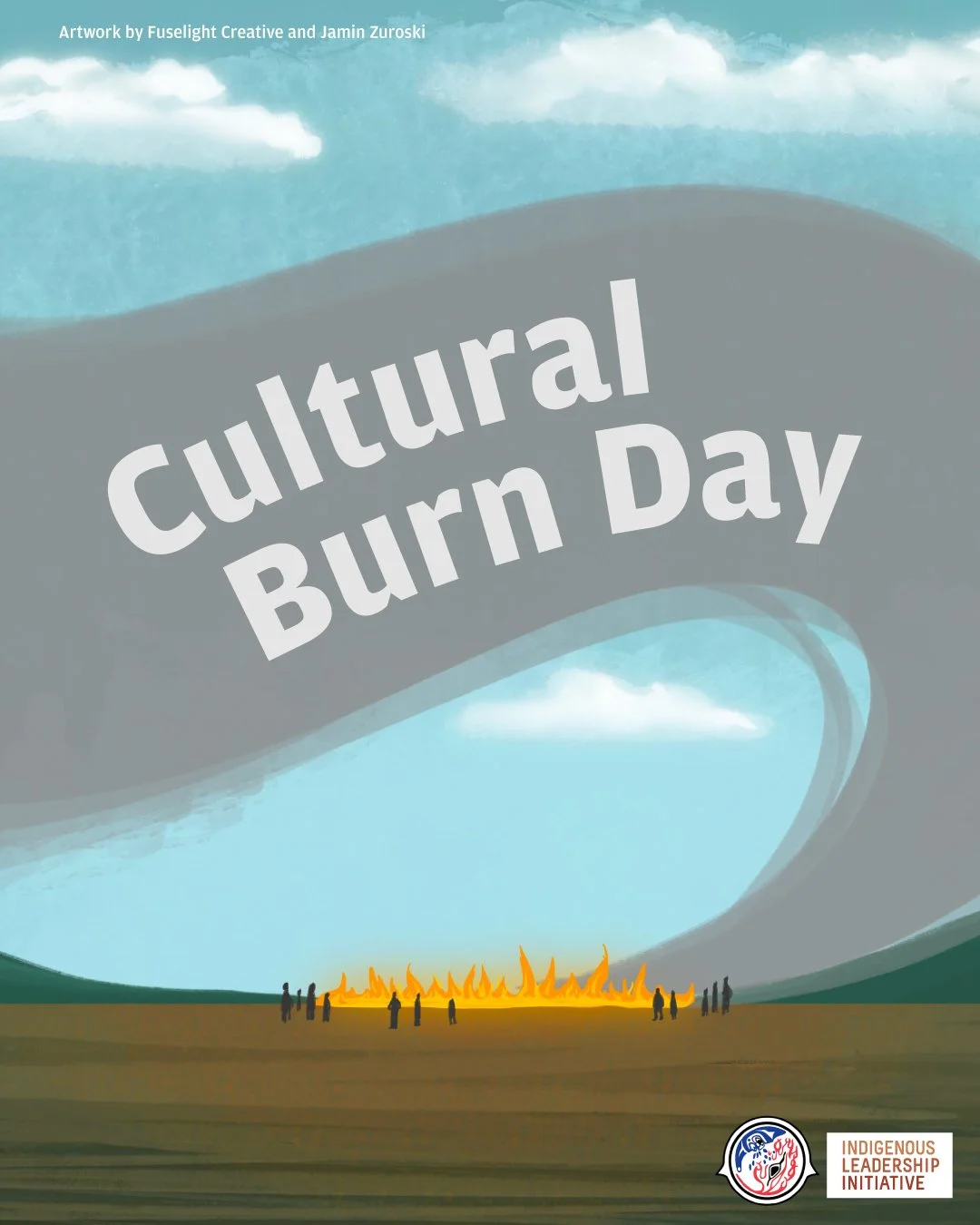GESTION DU FEU : Une nouvelle ressource aidera les nations autochtones à rétablir les brûlages culturels et à réduire les risques d’incendie
7 août 2025
Par Amy Cardinal Christianson, Ph. D.
Cet été, les habitants de nombreuses communautés autochtones, de la Colombie-Britannique au Québec, ont été évacués en raison d’incendies de forêt de forte intensité. Ce type de situation est désormais courant. Les recherches montrent que 42 % des évacuations liées aux incendies de forêt se produisent dans les communautés autochtones. Le risque croissant d’incendies incontrôlés menaçant nos maisons et nos territoires, ainsi que le sentiment douloureux lié au fait d’être évacués pendant des semaines ont contribué à la résurgence des brûlages culturels autochtones.
De nombreux peuples autochtones mènent des brûlages pour des raisons culturelles, notamment pour accroître l’abondance de baies et de plantes médicinales et réduire la quantité d’herbes desséchées et d’arbres malades, des matières combustibles qui attisent le feu lors d’incendies de forêt. Pourtant, un siècle d’application de la Loi sur les Indiens, d’expérience des pensionnats et de politiques colonialistes en matière de gestion du feu a entravé ces pratiques traditionnelles.
Plus tôt cette semaine, la First Nations Emergency Services Society (FNESS) et l’Initiative de leadership autochtone (ILA) ont publié un guide pratique à l’intention des nations autochtones qui souhaitent créer un programme de brûlage culturel afin de réduire les risques d’incendie de forêt et de revaloriser un élément essentiel de notre relation avec le territoire.
Renouer avec les brûlages culturels
Lors d’un atelier sur le brûlage culturel organisé par la FNESS et l’ILA ce printemps, Attila Nelson, membre de la Nation Lil'wat et spécialiste des brûlages culturels et dirigés à la FNESS, évoque le passé : « Quand mon père était enfant, le brûlage culturel était interdit en Colombie-Britannique; il était réalisé de manière officieuse ».
Dans l’ensemble du pays, les Nations ont été confrontées à des obstacles similaires en matière de brûlage. Mais les incendies dévastateurs des dernières années ont changé la donne. De nombreuses nations autochtones renouent avec le brûlage culturel dans le but de s’adapter aux changements climatiques, mais aussi pour restaurer les savoirs autochtones et renforcer le processus décisionnel autochtone sur le territoire.
De plus en plus, la population et un nombre croissant de services de lutte contre les incendies en reconnaissent l’utilité. « Je souhaite que le brûlage culturel favorise la croissance des plantes médicinales et le retour des animaux, tout en réduisant les risques d’incendie de forêt », déclare Attila Nelson. Ces retombées profitent à tous les Canadiens.
Mettre en place un solide programme de brûlage culturel
Dans le cadre de cet intérêt renouvelé envers le brûlage culturel, les nations autochtones présentent divers degrés d’expérience. Certains savent comment planifier et réaliser un brûlage, mais souhaiteraient davantage de soutien sur la manière d’évaluer l’état du territoire après un brûlage. D’autres, qui n’ont jamais discuté de brûlage avec leurs Aînés, veulent savoir comment aborder ce sujet.
Pour répondre aux besoins des Nations selon leur réalité, nous avons lancé un projet de recherche communautaire pluriannuel. Nous voulions que les Autochtones se reconnaissent dans le projet; nous avons donc fait participer plus de 50 Aînés et détenteurs du savoir, organisé de nombreuses rencontres et ateliers, procédé à de vastes examens par les pairs et révisé à plusieurs reprises le guide pratique pour tenir compte de l’ensemble des commentaires et suggestions.
Il en résulte un guide pratique comprenant sept fiches de travail utiles aux communautés dans l’élaboration d’un solide programme de brûlage culturel – peu importe l’étape où se trouve la Nation.
Le brûlage culturel est lié à la culture et au territoire. Ainsi, au lieu d’adopter une approche prescriptive, chaque fiche présente une série de questions et de pistes de réflexion auxquels il est possible de répondre collectivement.
Ces fiches fournissent des conseils sur la façon de recueillir les connaissances, d’aborder la question des espèces dépendantes du feu dont dépendent les communautés et d’examiner les conséquences de l’absence de brûlage sur le territoire. Elles indiquent comment parcourir le territoire et planifier un brûlage réussi, en plus d’inciter les communautés à intégrer des mécanismes d’évaluation et de suivi qui permettront d’évaluer les avantages culturels et les changements à long terme associés au brûlage d’une zone en particulier.
Des terres en santé, des communautés plus fortes
Les fiches de travail sont des documents d’orientation. En fin de compte, le brûlage culturel repose toujours sur les vastes connaissances qu’a une communauté de son territoire.
« Pour mener un brûlage traditionnel, nous nous appuyons sur les protocoles et méthodes employées autrefois pour brûler une zone de manière sécuritaire, explique Jordan Joe, de la bande indienne de Shackan. Il n’est pas question ici d’allumer tout bonnement un feu au pied d’une colline et de le regarder brûler. Ces brûlages étaient menés avec soin. »
Ce faisant, nous renouons avec nos traditions. Le brûlage culturel favorise la cohésion au sein de la communauté. C’est l’un des aspects qui me réjouit le plus. Les gens sont à l’extérieur, discutent, rient et apprennent de nouvelles choses. Lorsqu’on leur donne une torche pour démarrer le brûlage, un sourire éclaire leur visage. Nous veillons sur le territoire, ensemble. C’est un sentiment très agréable.
Nous espérons qu’un plus grand nombre de communautés utiliseront les fiches du guide portant sur la création de programmes de brûlage culturel et qu’ils partageront leur expérience.